

The harder they fall
Ben Wheatley. On commence à le connaître, le lascar. Un expert dans l'art de la provocation à des niveaux divers, thématique, esthétique, horrifique. Pour donner quelques éléments de contexte afin de mieux délimiter mon appréciation du présent High-Rise, il y a (presque) toujours eu chez lui un brin de folie ou un bout de culot me permettant d'en retenir des sensations grisantes. Ce qui conditionne mon ressenti, chose vraie partout ailleurs mais particulièrement prononcée chez le réalisateur britannique, c'est la modestie (ou l'absence de modestie) de l'ensemble, la façon de délivrer du contenu. La simplicité noire dans Touristes (Sightseers), la noirceur réaliste dans Kill List, et le réalisme social typiquement british dans Down Terrace allaient plutôt dans ce sens. Quelque part, certaines de leurs maladresses (d'écriture et de mise en scène) contribuaient à un certain capital bienveillance, à l'inverse du délire English Revolution (A Field in England, lire le billet) dont l'ampleur démesurée pouvait apparaître comme ridicule pour peu qu'on soit hermétique à ces hallucinations. Et clairement High-Rise appartient à cette deuxième catégorie, celle des délires originaux aux univers particuliers, même si le crédit revient principalement à l'auteur du livre que Wheatley adapte ici.
D'emblée, un constat s'impose : en adaptant le roman anglais du même nom de J. G. Ballard (publié en 1975), à l'univers dystopique dense, Wheatley prend dans une certaine mesure un risque similaire à celui que prenait David Cronenberg avec son adaptation de DeLillo, Cosmopolis (lire le billet). En imposant à l'écran les codes rigides d'un univers littéraire très lourd, très spécifique, et très métaphorique, on peut être sûr qu'une bonne partie du public s'arrêtera aux portes de l'ésotérisme. Mais là où la limousine de Robert Pattinson donnait corps à des réflexions plutôt subtiles et faisait pleinement sens encore aujourd'hui, le "high-rise" (sorte de HLM issu de la "brutalist architecture" au Royaume-Uni, dans les années 50/60/70) conçu par Jeremy Irons dans lequel évolue Tom Hiddleston laisse un arrière-goût amer de déjà vu. Un comble, ce manque d'originalité, étant donnés le sujet et le réalisateur — et le budget, sans commune mesure avec ses précédentes réalisations.

On saisit très vite le concept, la verticalité du bâtiment aux habitants répartis par strates sociales comme métaphore en dur de la société anglaise des années 1970, comme allégorie de la lutte des classes. Les classes populaires vivent dans les étages inférieurs, les aristocrates dans les quartiers luxueux les plus élevés, et les fameuses classes moyennes entre les deux condamnées à se positionner. Une schématisation de la société moderne déjà vues maintes fois au cinéma, y compris très récemment avec l'autre adaptation (en version horizontale) Snowpiercer, le Transperceneige réalisée par Bong Joon-ho pour son passage aux États-Unis. L'originalité de High-Rise réside plutôt dans l'observation d'une perturbation autour de cet état d'équilibre (instable, comme on l'apprendra bien assez tôt). Comment une panne de courant et des problèmes d'évacuation des ordures se répercuteront sur la répartition des classes sociales et sur les rapports de domination. Wheatley filme ainsi l'étincelle aux prémices d'une révolution et sa propagation à tous les étages comme une folie contagieuse qui gagnerait progressivement tous les occupants.
Le but de Ben (et de Ballard, sans doute, chose que je confirmerai sous peu), c'est de montrer que la crise provient du bâtiment lui-même plus que des êtres humains qui l'habitent. Du bas du bâtiment, même. La société plus que l'humanité, donc. Il faut donc y voir la volonté d'illustrer la fragilité des codes qui sous-tendent l'équilibre précaire des constructions humaines (architecturales dans le film, sociales dans la vie), et comment le basculement de l'homme civilisé vers l'instinct primaire peut s'opérer rapidement. Une idée on ne peut plus intéressante, mais encore faut-il en faire un objet cinématographique à la hauteur... Et c'est là que les ennuis commencent.
D'une part, le glissement du système ordonné vers un système dénué de repères moraux ou éthiques est affreusement bâclé. Il est évident que le film s'intéresse beaucoup plus à la description de l'état initial et de l'état final qu'à l'étape transitoire. Une transition relevant de la simple formalité (ou presque), conférant ainsi à l'ensemble du film un caractère étonnamment gratuit et complaisant, notamment dans l'observation de l'univers post-apocalyptique, aussi trash qu'inintéressant une fois passées les premières séquences présentant le chaos. Il y a quelque chose d'assez gênant dans la stagnation de l'intrigue une fois la révolution entamée, tant on a l'impression d'avoir fait le tour de la question longtemps (mais vraiment très longtemps) avant la fin, rendant la dernière partie particulièrement longue et pénible. On n'est plus dans l'originalité ou l'analyse, mais simplement dans la (dé)monstration. Montrer la lutte des classes dans un environnement abstrait : cela ne correspond pas vraiment aux promesses qu'un tel scénario et qu'un tel réalisateur laissaient suggérer. La stérilité du procédé se renforcera pour de bon dans un étalage de gratuité, en filmant un étalage de débauche. Le manque de subtilité se retrouve ainsi magnifiquement dans la citation finale, terriblement explicite, extraite d'un discours de Margaret Thatcher adressé en 1975 au Parti Conservateur. Thatcher, vraiment ? En 2016 ? On est bien loin de la conclusion corrosive du Cosmopolis de Cronenberg, qui pointait du doigt la responsabilité que nous portons tous, nous autres commun des mortels, dans le marasme économique actuel. Responsabilité qu'il est facile de rejeter sur l'autre, responsabilité dont on voudrait se défausser une fois la part du gâteau acquise et consommée.


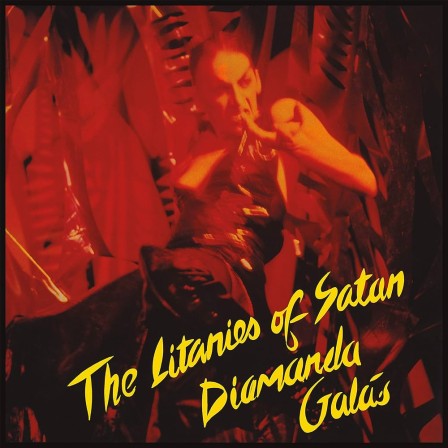




2 réactions
1 De Gilles Pi - 01/04/2016, 10:00
Merci pour l'avertissement. Ca fait longtemps que je dois jeter un sort à la trilogie du béton de Ballard, réuni dans un livre de poche qui poireaute au milieu de ma PAL. J'aurai certainement mal fait de sacrifier la peau de cette histoire sur l'autel des images qui bougent. Vu ta critique concernant l'adaptation du troisième volet au cinéma, il me semble judicieux de préférer la découverte de cet auteur contemporain mort il n'y a pas si longtemps par la lecture de ses romans et de ses nouvelles. Je connais déjà un peu le premier tome, Crash (1973), de la trilogie de Ballard via l'adaptation (1996) de Cronenberg dont il est un des films les plus connus.
I.G.H (Immeuble de Grande Hauteur) *titre original : High-Rise
2 De Renaud M. - 01/04/2016, 11:26
Ah ben c'est marrant que tu mentionnes cette trilogie, on vient justement de m'en prêter la version Gallimard que tu as mise en lien. J'ai hâte de découvrir ça par l'écrit (quand j'aurai terminé mon Conrad je pense) et voir si certains défauts font partie ou pas de l'œuvre originale... Et de découvrir aussi le matériau d'origine de Crash dont j'avais apprécié l'adaptation par Cronenberg. Merci pour ces précisions ! Tiens-moi au courant, si tu lis ça avant moi héhé.