

Affiches américaine et française du film.
Le culte de la transparence, l’opacité des apparences
Elle et lui, Amy et Nick : la caméra n’a d’yeux que pour eux. Rosamund Pike, actrice invisible dans tous ses films (dernière confirmation en date, le pénible What We Did on Our Holiday aux parfums écossais) qui crève subitement l’écran sous la direction de David Fincher. Et Ben Affleck, acteur transparent qui s’améliore, indéniablement. Tout commence comme l’un de ces contes de fées dont raffolent les médias américains : un journaliste natif du Missouri charme une écrivaine new-yorkaise, une histoire à l’eau de rose comme on en a déjà vu cent. Une rencontre filmée de manière on ne peut plus traditionnelle qui rappelle la rupture entre Jesse Eisenberg et Rooney Mara, filmée en introduction de The Social Network (lire le billet). Le couple roucoule gentiment et s’installe dans la ville du mari avant que le titre du film ne prenne son sens. Un jour, Amy disparaît.
Une heure durant, la caméra de Fincher traque Nick et observe méticuleusement ses faits et gestes. Elle resserre progressivement l’étau autour de celui que tout accuse. C’est un meurtre presque acté tant les détails l’incriminant abondent : seul le corps fait défaut. La victime est un symbole de perfection, irréprochable aux yeux des télévisions devant lesquelles le mari, un peu maladroit, semble incapable de jouer le jeu des larmes que tous attendent. Les talents de conteur du réalisateur transpirent de ce premier récit, à travers un montage parallèle sous forme de flashbacks maintenant Amy à l’écran. Son journal intime explique le déroulement des épisodes précédents alors que l’enquête progresse dans un habile mélange de passé et de présent. Puis, tout à coup, tout bascule, à l’image de ces anamorphoses picturales qui se déforment et changent totalement de sens par simple déplacement du regard. Faux suspense et faux twist (“Qu’est-il arrivé à Amy ?”, “Qui est le coupable ?”), ce n’est que le deuxième temps d’une valse qui en comptera trois.Comme souvent chez Fincher, le récit progresse de manière logique et mécanique : procédures et micro-enquêtes, dispositifs décrits de manière clinique et énigmes à double fond… une tension qui va crescendo en intensité, jusqu’au vertige, et qui s’articule autour d’une inconnue. Le réalisateur tape-à-l'œil de Fight Club a clairement délaissé cette esthétique de publicitaire pour quelque chose de plus mature, comme l’ont déjà démontré Zodiac et The Social Network (envie de le relire ?). Jamais le vocabulaire technique de la mise en scène de Fincher n’aura trouvé de résonance aussi forte avec son sujet : la soif insatiable de transparence du monde médiatique contemporain ne produit, paradoxalement, qu’opacité, illusion, et réversibilité des vérités et de l’opinion. Des apparences fondamentalement trompeuses, bien sûr, mais aussi et surtout monnayables (lire la critique de Senscritchaiev à ce sujet : lien vers la critique).
Dommage que le plaisir cynique avec lequel Fincher décrit notre époque, cette façon stupide de relayer la moindre rumeur et de s’en tenir effrontément aux apparences, tourne à vide très rapidement. Ou, du moins, sur des sentiers largement balisés par le cinéma critique de ces quarante dernières années, de Sidney Lumet à David Cronenberg en passant par Peter Weier. Peut-être manque-t-il un point d’appui un peu plus profond ou plus mystérieux (plus intéressant ?) que l’évidente métaphore du mariage comme enfer consenti. Fincher, à l’inverse, cherche à tout expliquer et à verrouiller toutes les pistes, non sans humour et ironie (tous deux féroces). Un scénario trop écrit, trop sophistiqué, trop sûr de ses effets et de ses réponses qui empêche la mise en scène de Fincher, toujours impériale et virtuose, de se déployer entièrement. Il est cependant amusant de constater comment ce qu’on croyait être des défauts d’écriture du scénario se transforment (pour certains) en défauts de l’enquête policière, et donc autant d’éléments à charge contre la justice américaine.Si l’on oublie ses petit défauts, Gone Girl se savoure avec délectation. On rit devant cette guerre des images que se livrent les deux ex-tourtereaux, et on pleure devant ces médias et autres réseaux sociaux qui construisent un monde en accord avec nos désirs et qui, in fine, fabriquent de la pathologie ordinaire.


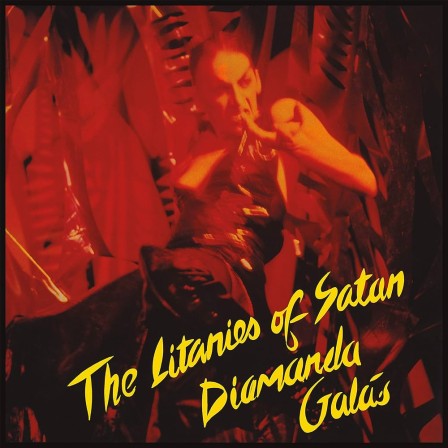




2 réactions
1 De Olivier - 26/10/2014, 02:00
C'est fou ce que je retrouve mon opinion du film dans cette critique, ici mieux rédigée, pour sûr (on va dire que c'est l'habitude de l'exercice ^^).
Pas un mot cependant (ou un demi) sur la vision du mariage proposée dans ce film, que j'ai trouvée assez osée, ce qui est à l'honneur du réalisateur tant la famille est LA valeur centrale de la société américaine, nous dit-on.
"Ben acteur transparent" je dis oui, "qui s'améliore" je dis non... au mieux qui est dirigé par un réalisateur bon ou exigeant, ou les deux, à mon avis.
Pour le reste, je suis d'accord ! :-)
Merci
Olivier
2 De Renaud M. - 26/10/2014, 13:00
Salut Olivier, et merci d'être venu t'attarder ici ! =)
C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose sur ces aspects liés au mariage dans cette bafouille. Il y a plein d'autres points intéressants qui ne sont pas abordés d'ailleurs... Mais encore une fois, je n'ai pas trouvé ça extrêmement passionnant ni tellement audacieux. Ou peut-être trop attendu, pour moi. Bon, bien sûr, si on compare le cinéma de David Fincher à celui, très conservateur, de celui de Clint Eastwood (un exemple parmi des centaines d'autres), c'est très osé en effet.
Quant à Ben Affleck, il s'améliore, certainement grâce à la rigueur de Fincher, mais c'est déjà un pas de géant dans sa carrière héhé... J'ai hâte de voir ce que donnera sa prestation dans la peau Bruce Wayne, à l'occasion du prochain film de Zack Snyder !