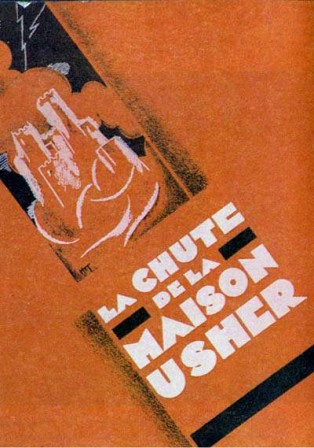
Première publication le 03-10-2019.
Le cinéma expérimental des années 20 et 30 a quelque chose de vraiment passionnant, pour peu que l'on soit réceptif aux univers expressionnistes, aux poèmes surréalistes, ou encore aux contes gothiques. Sans aller du côté des expériences les plus extrêmes à la Dziga Vertov (L'Homme à la caméra sortira un an plus tard) ou comme La Passion de Jeanne d’Arc de Dreyer sorti la même année, il serait tentant de voir dans la démarche furieusement avant-gardiste de Jean Epstein le prolongement de travaux initiés par d'autres bâtisseurs comme Robert Wiene ou Friedrich Wilhelm Murnau. Le gothique de certaines séquences (notamment le transfert du cercueil de Lady Madeleine vers la crypte, à travers un bois brumeux et menaçant) semble réactualiser les codes définis par Nosferatu le vampire (1922) tandis que l'altération des décors lorsque Sir Roderick Usher sombre dans la folie peut se voir comme un vague écho des transformations très anguleuses dans Le Cabinet du docteur Caligari (1920) — dans l'effet que ces transformations produisent sur la perception du réel.
L'adaptation de Poe laisse à Epstein une grande latitude dans l'exploitation des atmosphères à la fois mystérieuses et inquiétantes : au-delà de la pure modernité de la mise en scène du point de vue strictement technique, il semble toujours y avoir un souci de l'effet produit. Il y a des mouvements de caméra très étonnants pour l'époque ainsi qu'une utilisation assez classique de la surimpression, mais certains effets extrêmement simples charpentent des atmosphères d'une incroyable singularité. C'est notamment le cas à l'apogée de la thématique principale, celle de la vampirisation par l'œuvre artistique : alors que le peintre termine son tableau, après qu'il a entièrement absorbé l'essence vitale de son modèle, un simple ralenti sur le corps de la femme, dans sa chute, produit un effet envoûtant, presque terrifiant, comme un électrochoc de poésie fantastique.
Cette manipulation du temps est d'ailleurs omniprésente dans la seconde partie du film, avec une dilatation étrange qui produit une ambiance très particulière, alors que le protagoniste se morfond dans le déni. Dans ces atmosphères où la poésie bourgeonne au creux d'un temps suspendu, où l'on ne sait jamais sur quel pied danser, entre réalisme et onirisme, on se croirait sur (voire sous) le bateau de L'Atalante — d'autant que dans ce dernier, fruit du cinéma parlant, Jean Vigo jouait beaucoup avec des codes du muet.
Plus que le discours sur l'absorption de l'être par l'art et sur la douleur qui accompagne le processus créatif, à travers le dépérissement du modèle consumé par le pinceau de l'artiste mais aussi la résurrection fantomatique de cette dernière dans la destruction de la demeure, ce sont toutes ces images qui resteront en mémoire, en l'assaillant de ses impressions fantastiques. Décidément, Finis Terrae et sa poésie documentaire semble à des années-lumière... alors qu'il sortira l'année suivante. La suggestion morbide hante tout le film, dans cette histoire de possession jusqu'à la mort, et nourrit une forme de catalepsie dont on ne ressortira qu'à travers les flammes d'une maison détruite.

Seconde publication le 24-01-2021.
Un an et demi après le premier visionnage, mon point de vue a très peu changé. Je dialogue de manière totalement synchrone avec mon moi de 2019, et je suis très en phase avec ce que j’écrivais alors : cf. ci-dessus. Un signe de bonne santé mentale, serait-on tenté de dire... Certes.Quelques éléments supplémentaires, cependant, puisque cette nouvelle confrontation avec l'univers de Poe passé à travers le filtre d'Epstein s'opère cette fois-ci au terme d'un voyage parcellaire à travers sa filmographie, depuis ses débuts du côté des studios Albatros jusqu'à la période d'indépendance au sein de sa propre société de production — dont La Chute de la maison Usher signe l'arrêt de mort. Œuvre de transition par excellence, elle contient à la fois toute la diversité technique qu'Epstein aura développée et perfectionnée au cours des 5 années précédentes, à laquelle s'ajoute un univers fantastique jusqu'alors totalement inédit dans son parcours. Un imaginaire onirique et macabre qui peut rappeler, sous certains aspects seulement, le Vampyr que Dreyer réalisera 4 ans plus tard. Mais attention aux ponts lancés trop vite, car s'il est toujours tentant de relier quelques séquences à un expressionnisme allemand, Epstein exprimait ouvertement son aversion pour des films comme Le Cabinet du docteur Caligari.
La modernité de la mise en scène reste vraiment incroyable, que ce soit dans le point de vue subjectif de certains travellings avant (ce plan au ras du sol, dans un couloir, au milieu des feuilles tourbillonnantes et des rideaux malmenés par un vent puissant !), dans les ruptures de rythme et de style pour figurer les différents temps du récit, dans les ambiances tissées avec délicatesse — la figuration par surimpression du mal qui s'empare de Madeleine (interprétée par Marguerite Gance, la femme d’Abel) lorsque Roderick apporte les derniers coups de pinceau à son portrait... Un poème gothique très court, finalement, à l'échelle de sa filmographie des années 20, qui marque un tournant esthétique sidérant avec le recul. La femme donne sa vie pour un tableau (un peu comme Epstein sacrifie sa société de production pour voir naître le film), et sa résurrection coûtera au couple son manoir, l'un et l'autre étant tragiquement liés.










Dernières interactions
Ah je serais très heureux d'avoir ton avis là-dessus ! C'est mon gros coup de…
24/06/2025, 11:54
Merci pour cette chronique sensiblement enthousiaste. Il est fort parfois le…
24/06/2025, 10:49
Ouch ou encore Civil war d’Alex Garland (2024)
12/06/2025, 16:03
Décidément, on se rapproche de l'introduction d'un prochain volet d'American…
12/06/2025, 10:19
Ah je trouve La Jetée beaucoup plus immédiatement appréciable que The Stalker…
09/06/2025, 11:21
Je suis mauvais élève, je n’ai pas vu le film. Mais j’ai ouï dire que le sens de…
08/06/2025, 22:50