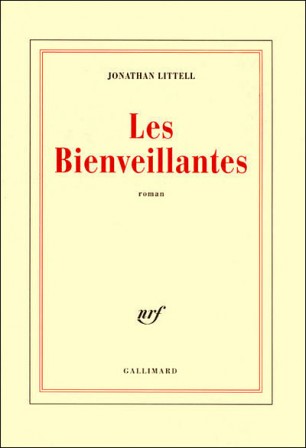
Réalisme horrifique contre réalisme historique — Deux façons de raconter la Seconde Guerre mondiale
À mi-chemin entre l'œuvre de fiction et le document d'Histoire, Les Bienveillantes plonge dans les rangs allemands durant la Seconde Guerre mondiale et propose un périple "de l'intérieur" au très long cours. À l'opposé du témoignage autobiographique d'un soldat ordinaire que nous offrait Guy Sajer dans l'excellent Le Soldat Oublié (lire le billet), le franco-américain Jonathan Littell endosse les habits de romancier (surtout) et d'historien (aussi) pour raconter l'histoire franco-allemande de son personnage fictif, Maximilien Aue, de simple membre des Einsatzgruppen (groupes d'intervention) au rang de SS-Obersturmbannführer (lieutenant-colonel). Une chronologie morbide et nauséeuse liant les vices personnels d'un homme aux vices historiques nazis à travers les événements du front Est, principalement, des massacres autour des fosses communes en 1941 à la chute de Berlin en 1945, en passant par la bataille de Stalingrad en 1942-1943.
C'est un rapport délicat à la réalité car d'un côté, on ne peut pas nier la qualité du travail de documentation qui émane des nombreuses descriptions des lieux, des batailles, des hiérarchies, et des rouages de l'institution nazie. Mais il y a aussi une forme d'acharnement dans l'écriture du personnage central, un concentré de vices (indépendants de l'idéologie nazie) en la personne de Aue qui produit une certaine gêne, loin du malaise qu'est censé produire intrinsèquement une telle accumulation de maux. En accordant autant d'importance à des obsessions sexuelles hors du commun, partagées entre le désir inceste pour sa sœur jumelle et ses pulsions homosexuelles frénétiques (rappelons que l'homosexualité n'était pas un trait franchement avouable quand on désirait faire carrière dans la SS), en apportant autant de soin à la description des horreurs multiples de la guerre à base d'os qui se brisent et d'organes qui se déversent, un malaise tout autre se fait jour. Comme si l'horreur devenait un objet de fascination, comme si on alimentait en monstruosités diverses un public venu chercher des exemples de l'abjection nazie. Et en construisant ainsi un personnage littéralement extraordinaire, anormal au sens premier (ceux qui ont lu le livre se remémoreront les rapports que Max entretient avec sa sœur, et ce depuis l'âge de 14 ans), Littell s'éloigne significativement de la thèse de Christopher R. Browning sur les "hommes ordinaires" (lire le billet). Ce n'est pas un reproche en soi, cela reste une fiction, l'auteur cherche à nous surprendre et nous déstabiliser tout comme son personnage cherche à nous convaincre de son innocence ou du moins du bien-fondé de sa démarche intellectuelle, mais c'est un procédé qui ne m'intéresse pas particulièrement.
Du point de vue du style pur, le livre n'ayant pas la valeur d'un témoignage comme d'autres œuvres biographiques ou autobiographiques, Les Bienveillantes n'est pas un chef-d'œuvre de la littérature. L'auteur, par ce regard frontal et contraignant, empêche toute prise de distance et souhaite nous faire vivre l'engagement nazi de Aue pour le peuple allemand au plus près de la réalité. On peut distinguer ici trois types de réalisme :
► Le réalisme historique, très appréciable, qui s'attache à décrire avec précision la hiérarchie et les lieux dans lesquels évolue le protagoniste. Que ce soit l'emploi catégorique de l'Allemand pour nommer les rangs, la vision d'ensemble de la politique du régime nazi, ou plus prosaïquement les décors des différentes villes et communes européennes, c'est un tout immersif et bien documenté. L'affectation/punition de Max à Stalingrad durant ses derniers jours sous le contrôle du Troisième Reich, avant l'assaut des forces de l'URSS, est un temps extrêmement fort. Les intersections du récit avec l'Histoire son nombreuses, mais le millier de pages permet de les espacer dans le temps. Certaines rencontres sont plus réussies que d'autres, et on retiendra par exemple la découverte des milieux d'extrême droite autour de Robert Brasillach sous l'Occupation. Max sera amené à côtoyer les plus hauts responsables nazis, le
Reichsführer Heinrich Himmler, le responsable de la logistique de la
"Solution finale" Adolf Eichmann, ainsi qu'Adolf Hitler en personne lors d'une remise de médaille aussi brève que ridicule (il lui pince le nez avant d'être jeté aux arrêts).
► Le réalisme horrifique, évoqué plus haut, qui me semble assez discutable, et qui ne sert qu'à adjoindre à l'horreur de l'Histoire celles vécues et contenues par son personnage. Des passages pénibles à lire, ornés de comparaisons hasardeuses et de détails dont on se serait facilement passé. Jonathan Littell se sent obligé de perdre son personnage dans des élucubrations philosophiques peu engageantes, en reliant par exemple les théories de Hobbes aux idéaux nationaux-socialistes autour des thèmes de l'état de nature et du contrat social. Les réflexions sur le bien, le mal, la notion d'inhumain et de nécessité
("aveugle et cruelle chez les Grecs") semblent assez limitées, et c'est bien l'auteur qui semble s'exprimer, parfois, à travers les divagations "neutres" de son personnage.
► Le réalisme purement fictionnel, en lien avec les délires qui assaillent continuellement Max, qui trouvera son apogée dans une des dernières séquences, lorsqu'il se retrouve dans l'ancienne maison de sa sœur en Poméranie. Un long moment d'hallucinations dures et répétées, qui non seulement contribuent à tisser une ambiance loufoque et dérangée, parenthèse en dehors de l'Histoire qui se déroule devant sa porte, mais qui jettent également un doute saisissant sur tous les événements passés. Si Max est en proie a des hallucinations aussi fortes, aussi réelles, aussi aliénantes, quel regard doit-on poser sur ce qu'il nous a raconté au sujet du meurtre de sa mère et de son compagnon à Antibes ? C'est un passage-clé du livre qui présente un réel intérêt du point de vue de l’écriture du roman et de l'histoire qu'il raconte.
L'intérêt principal de cet objet aux contours incertains, pour sa partie fictionnelle, réside donc dans les aléas intérieurs de Maximilien Aue, à la limite de la schizophrénie. Comme partagé entre une part de son être qui assume totalement son engagement nazi, une froideur dénuée de désarroi moral, et une autre qui somatise violemment à travers la répétition de vomissements et de diarrhées aiguës. On peut même voir dans la figure des deux policiers, Clemens et Weser, qui le poursuivront sans relâche dans la dernière partie du livre dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de sa mère, une forme de matérialisation de sa conscience torturée. Deux vieux démons qui ne le lâchent pas et qui abordent la question des crimes "civils" (si tant est que cela existe) commis pendant la guerre, à l'image du major Grau et d'une enquête similaire dans La Nuit des généraux d’Anatole Litvak. C'est là un des objectifs de Littell, construire l'image d'un "gentil méchant" parmi les "méchants", un nazi moins nazi que les autres, notamment à travers son rôle actif dans la gestion de la capacité productive du "réservoir humain" que constituent les prisonniers juifs. Aue s’attellera à les faire travailler et à les alimenter correctement, contre l'avis général, plutôt que de les tuer. Comme s'il se dégageait de cette approche froide une forme d'objectivité neutre (mais la notion de neutralité existe-t-elle dans ce genre de guerre ?), en traitant la force de travail juive comme n'importe quelle autre force de travail qui œuvrerait à la réussite d'une industrie quelconque. Mais les toutes dernières pages n'oublient pas de nous rappeler (au cas où on l'aurait oublié) le mal absolu que Max contient en lui, ultime sursaut d'horreur qui lui permettra de sortir libre de cette guerre, muni des papiers d’un Français du STO, en tuant froidement et lâchement un de ses derniers amis.






Dernières interactions
Ah je serais très heureux d'avoir ton avis là-dessus ! C'est mon gros coup de…
24/06/2025, 11:54
Merci pour cette chronique sensiblement enthousiaste. Il est fort parfois le…
24/06/2025, 10:49
Ouch ou encore Civil war d’Alex Garland (2024)
12/06/2025, 16:03
Décidément, on se rapproche de l'introduction d'un prochain volet d'American…
12/06/2025, 10:19
Ah je trouve La Jetée beaucoup plus immédiatement appréciable que The Stalker…
09/06/2025, 11:21
Je suis mauvais élève, je n’ai pas vu le film. Mais j’ai ouï dire que le sens de…
08/06/2025, 22:50